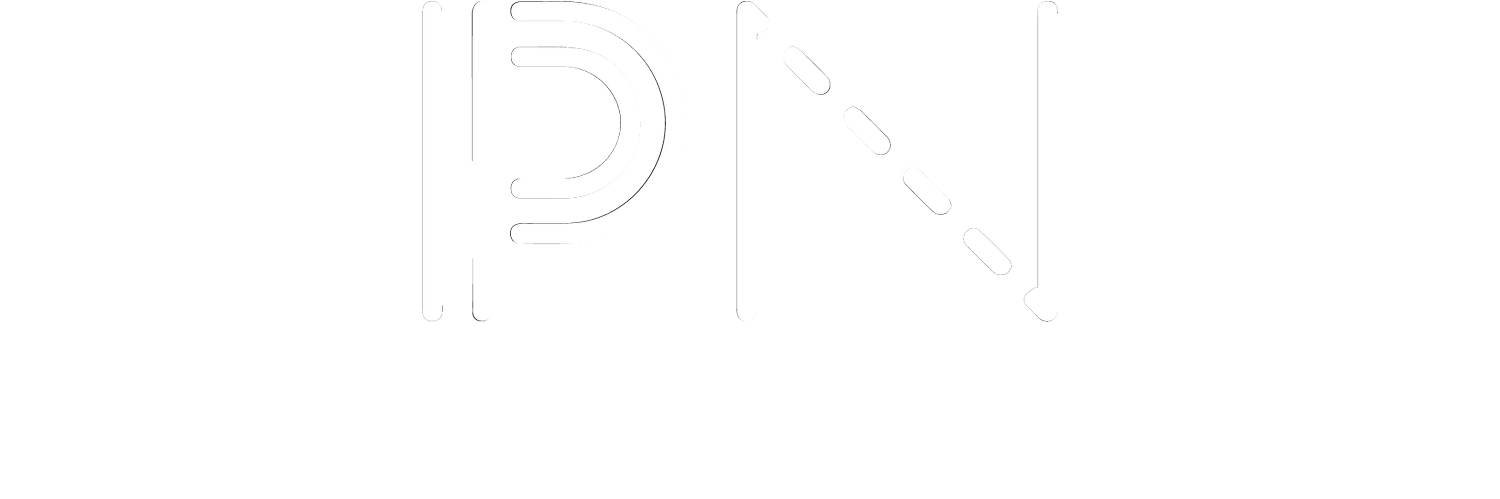Rail contre Aérien : un faux procès
L’étude publiée par Greenpeace met en évidence une réalité gênante pour le rail européen : sur près de 60 % des liaisons analysées, l’avion reste moins cher que le train, malgré l’argument écologique. Les cas les plus frappants concernent Barcelone–Londres, où un billet de train atteint 389 € contre 14,99 € en avion, un voyage qui émet cependant 47 fois plus de carbone par les airs que par les chemins de fer, selon le calculateur de l’Agence de la transition écologique (Ademe). . En France, la situation est encore plus marquée, les péages ferroviaires étant parmi les plus élevés d’Europe (21 €/km contre 5 à 7 € en Allemagne, Italie ou Espagne). Greenpeace accuse l’exonération du kérosène et l’absence de TVA internationale dans l’aérien d’introduire un biais fiscal, et appelle à des « billets climat » et une taxation accrue du transport aérien.
L'analyse de l'APNA:
Le dernier rapport de Greenpeace dénonce l’avantage fiscal de l’avion sur le train. Mais les faits sont têtus : au-delà de 500 km, c’est bien le rail qui souffre de coûts structurellement plus élevés.
Rappelons que le rail bénéficie déjà de 19 milliards d’euros de subventions annuelles, alors que l’aérien assume seul :
Le financement de sa régulation (DGAC) par ses propres acteurs,
Le coût de la sûreté, mission régalienne, entièrement payé par les compagnies,
L’absence totale de subventions publiques d’exploitation.
Comparer un billet d’avion à 14 € avec un billet de TGV à 389 € est une illusion : ce tarif d’appel de 14€ ne couvre même pas les taxes et ne reflète pas la réalité économique complète.
Concernant l’impact écologique, il est indéniable que l’avion émet davantage de CO₂ par passager-km qu’un TGV. Mais cette comparaison d’émission de CO2, 47 fois supérieure de l’aérien, oublie le cycle de vie complet du train : construction des lignes (béton, acier), entretien permanent, recyclage du matériel. Sans compter l’impact majeur sur la biodiversité : artificialisation des sols, fragmentation des habitats et collisions avec la faune. Le calculateur de l'ADEME intègre de plus - contrairement à ceux de la DGAC ou de l'OACI - les effets non-CO2 du transport aérien et en double ainsi les émissions. Il convient de noter à cet égard que cette évaluation des effets non-CO2 ne fait aujourd'hui l'objet d'aucun consensus scientifique et que les travaux sur le sujet se poursuivent tant au niveau national (chaire Climaviation) qu'européen. Ces affirmations répétées selon lesquelles ce serait une fiscalité avantageuse qui expliquerait que le train est supposément plus cher que l'avion ont déjà fait l'objet d'une condamnation par le Jury de la Déontologie de la Publicité le 6 octobre 2023 (JDP Fer de France https://www.jdp-pub.org/avis/fer-de-france-internet/)
Le rapport Le Roux (2014) avait déjà mis en lumière l’ensemble des charges et contraintes spécifiques supportées par l’aérien, montrant qu’il reste le seul mode non subventionné à assumer intégralement ses coûts. L’arbitrage sur la transition ne doit donc pas passer par un subventionnement supplémentaire d’un rail déjà sous perfusion, mais par une logique d’efficience globale des actions de décarbonation. Et surtout, dans un monde concurrentiel, toute taxation environnementale doit s’appliquer uniformément à tous les acteurs, quel que soit le pays, faute de quoi elle détruit la compétitivité nationale sans bénéfice climatique réel.
L’équité, c’est de comparer tous les coûts, toutes les externalités, et d’appliquer les mêmes règles de calculs à tous.
Exiger de « taxer l’aérien » au nom de l’équité revient à ignorer que seul l’aérien paie l’intégralité de ses charges, pendant que le rail vit sous perfusion.