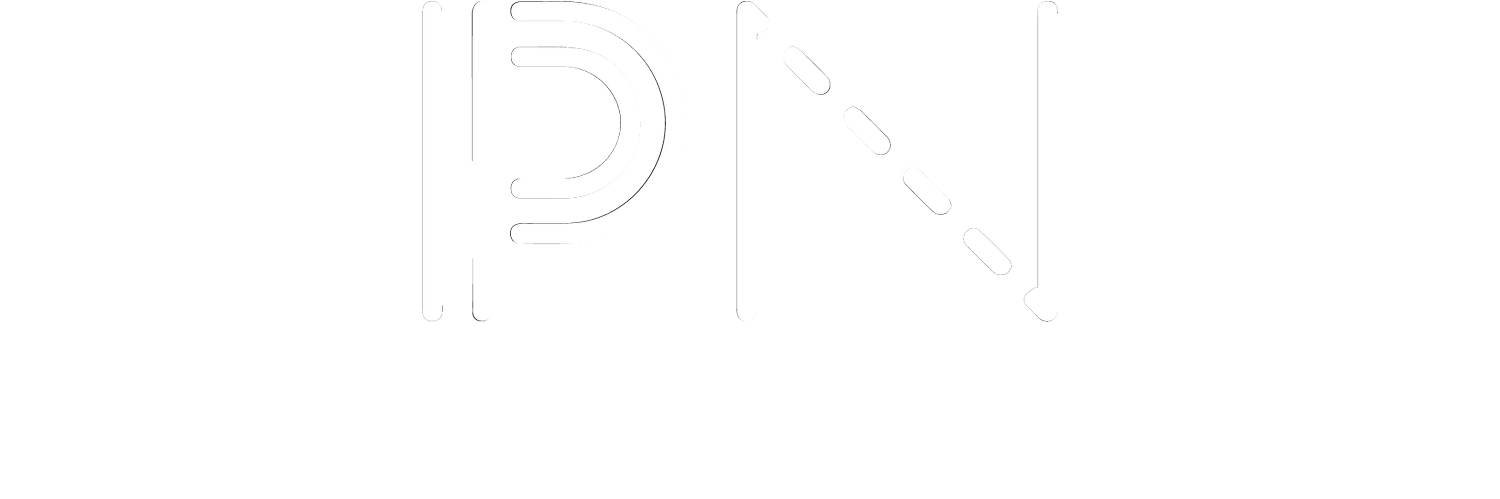Les retombées toxiques du fuel dumping
Le 14 janvier 2020, le vol Delta 89 reliant Los Angeles à Shanghai a dû revenir en urgence après une panne moteur peu après le décollage. Pour atterrir en sécurité sans dépasser la masse maximale autorisée, l’équipage a largué près de 15 000 gallons de carburant à basse altitude au-dessus de quartiers densément peuplés, touchant des écoles et des habitations. Conséquence : irritations cutanées et respiratoires pour 56 personnes, fermetures temporaires d’écoles et nettoyage des zones touchées.
Delta a accepté en 2025 de verser 78,75 millions de dollars pour solder un recours collectif engagé par les riverains. L’affaire a ravivé le débat sur la réglementation des vidanges carburant : jusqu’ici, on considérait que le kérosène se vaporisait entièrement avant de toucher le sol. En réalité, des études montrent que des résidus toxiques (benzène, hydrocarbures persistants) retombent au sol et contaminent l’air, les sols et les eaux.
L'analyse de l'APNA:
Cet incident a mis en lumière une double réalité :
La nécessité sécuritaire : le fuel dumping est parfois la seule solution pour ramener un avion à une masse d’atterrissage compatible avec la structure et le freinage. La sécurité des vols reste prioritaire.
La limite du modèle de croyance : on pensait jusqu’ici que le carburant largué s’évaporait totalement dans l’atmosphère. L’épisode de Los Angeles a démontré que larguer à basse altitude sur une zone habitée entraîne des dépôts réels au sol, avec des conséquences sanitaires et environnementales mesurables. Le respect des altitudes de vidange carburant permet de réduire largement les retombées sachant que ces les zones de vidange sont localisée au-dessus de zones inhabitées telles que de la mer ou de zones forestières
Les carburants d’aviation durables (SAF) qui devraient remplir à 80% les réservoirs d’avion d’ici 2050 ne devraient polluer les sols que très marginalement lors des vidanges en vol.