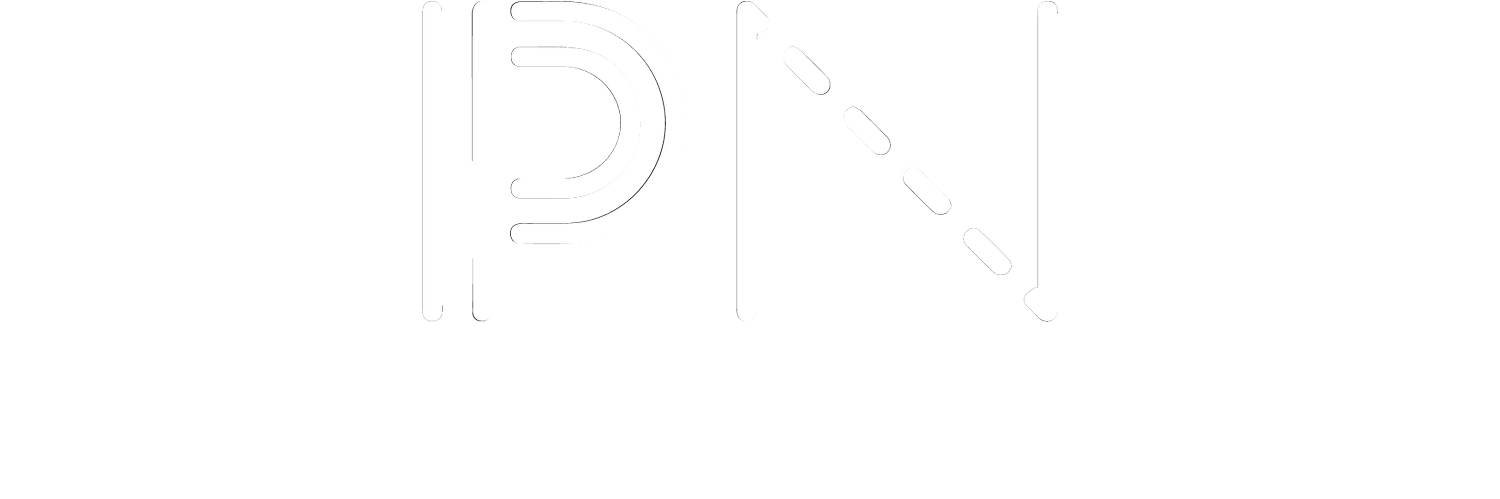L’enjeu de l’évitement des zones génératrices des trainées de condensation
Les traînées de condensation (« contrails »), formées par la vapeur d’eau et les particules issues de la combustion des réacteurs, représentent un enjeu climatique majeur. Elles peuvent évoluer en cirrus et piéger le rayonnement terrestre, générant un impact radiatif comparable à celui du CO₂. Selon Eurocontrol, 2 à 12 % des traînées seraient responsables de près de 80 % de l’effet climatique.
Le projet Climaviation, piloté par l’Onera et l’Institut Pierre-Simon-Laplace, vise à mieux quantifier ces effets pour affiner les modèles climatiques. Plusieurs expérimentations sont en cours : reroutage sélectif des vols (« big hits »), simulations menées par Air France, EasyJet, Swiss ou Delta, et essais réels coordonnés par Thales et Eurocontrol. Les résultats montrent que 4 % des vols peuvent représenter jusqu’à 80 % de l’impact « non-CO₂ » et qu’un léger détour, même au prix d’une surconsommation marginale de kérosène, permet une réduction nette du réchauffement.
L'analyse de l'APNA:
La problématique des traînées de condensation illustre bien la complexité du défi climatique de l’aviation : au-delà du CO₂, les éventuels « effets non-CO₂ » pourraient désormais être intégrés à la stratégie globale de décarbonation. Leur impact réchauffant exact reste encore en débat scientifique : les études divergent sur l’ampleur de leur effet, d’autant plus que celui-ci est transitoire, limité à la durée de vie des traînées (quelques heures ou jours), alors que le CO₂ s’accumule pour des décennies.
En attendant que la science stabilise ses conclusions, il pourrait être pertinent d’agir sur les leviers opérationnels existants : adaptation d’altitude, optimisation des trajectoires, descentes continues — pour autant que les émissions supplémentaires générées par les trajectoires d’évitement et les complexités induites en matière de navigation aérienne ne se révèlent pas rédhibitoires.
Pour la France, qui dispose d’un écosystème scientifique et industriel de pointe (Onera, CNRS, Climaviation, Airbus, Thales), c’est une opportunité stratégique de déterminer les hypothèses de travail, sachant que lors des journées ensoleillées, les cirrus sont réfléchissants des rayons du soleil, mais sont à effet réchauffant la nuit en retenant le rayonnement infrarouge terrestre qui, autrement, s’échapperait vers l’espace.
Par exemple, de récentes recherches semblent montrer que dans certaines conditions de vol (notamment au FL350), le rayonnement infrarouge peut traverser les trainées de condensation sans interaction notable et donc n’avoir aucun effet sur le forçage radiatif. Bref, le temps est encore à la consolidation de la base scientifique plutôt qu’à se lancer dans des expérimentations opérationnelles qui sont loin d’être anodines.
On comprend les intérêts des ONG qui doublent l’effet CO₂ de l’aérien dans leur communication, promeuvent le principe de précaution et militent pour un renchérissement du transport aérien, ou encore de certains industriels qui voient une opportunité commerciale pour leurs technologies. Mais il nous semble que la connaissance scientifique doit prévaloir à ce stade. La question de l’identification fiable et en temps réel des zones de formation des traînées de condensation reste, par ailleurs, un sacré défi météorologique.